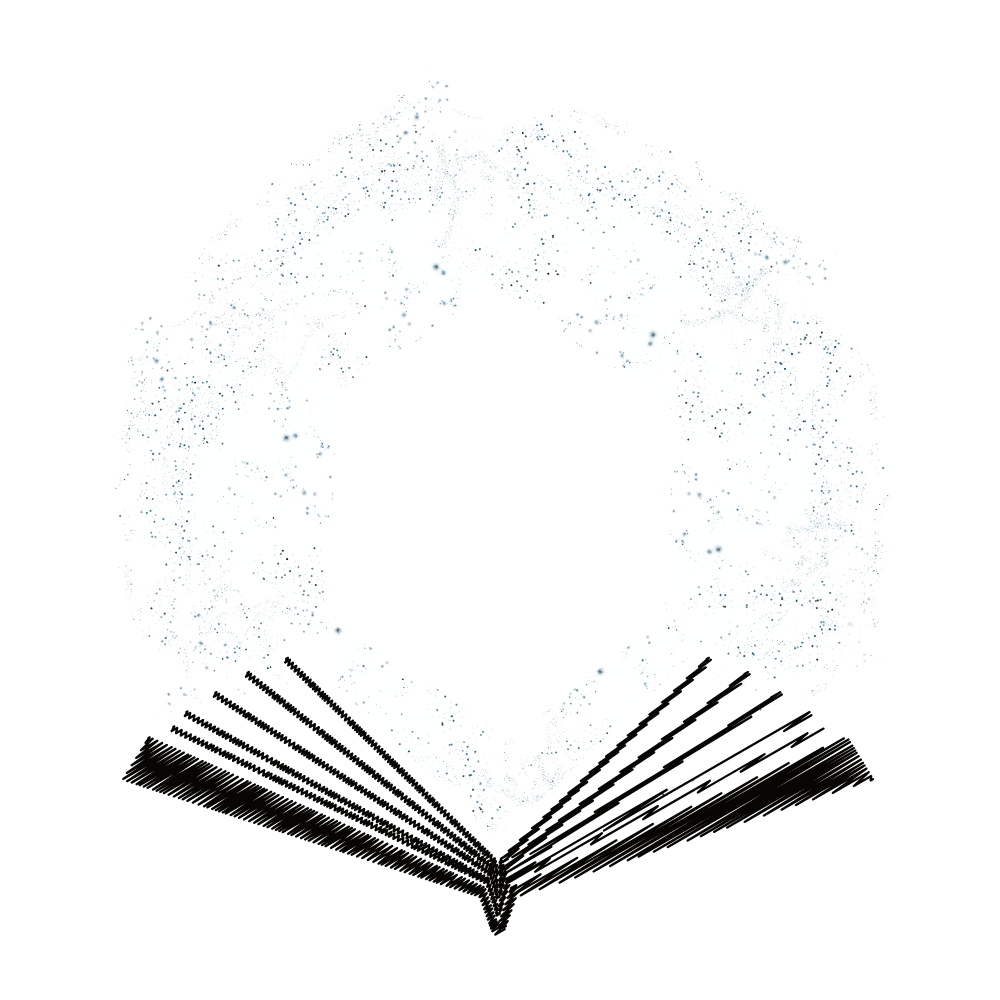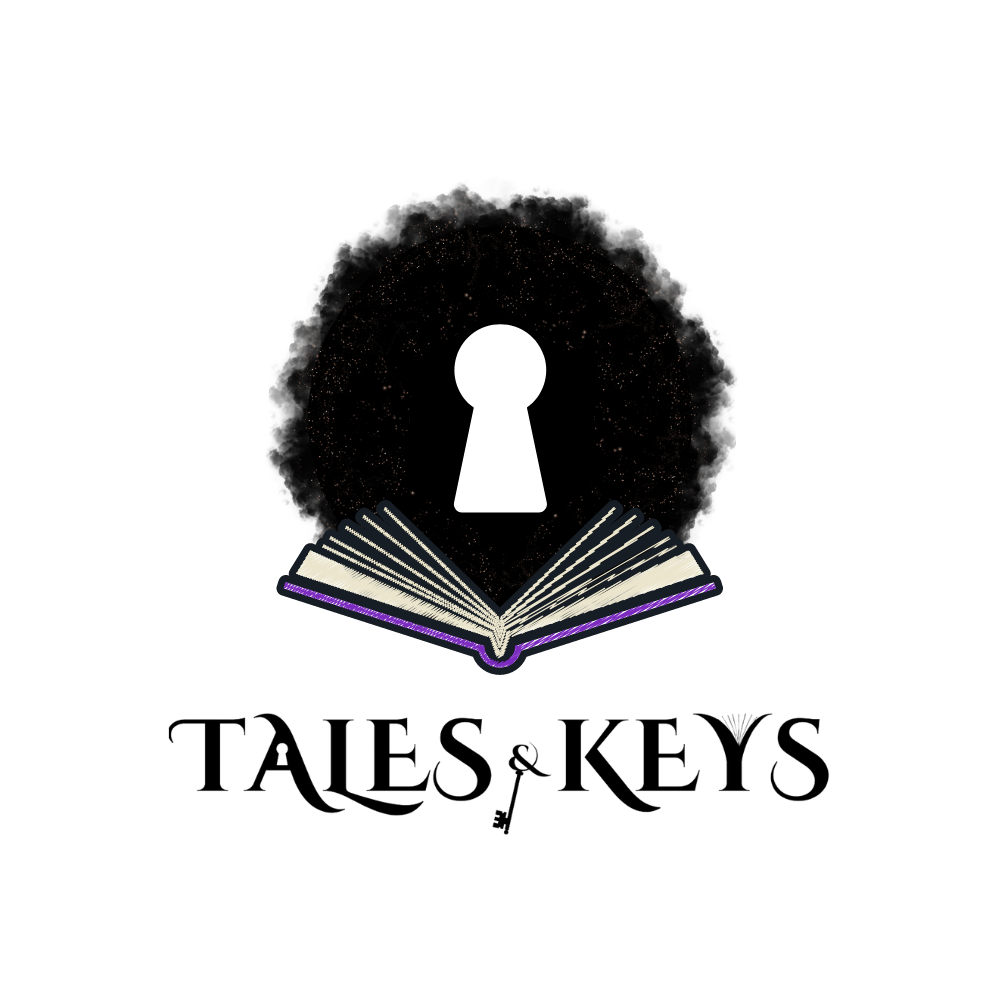Place Rihour

Le nom de la place est mentionné pour la première fois dans l’acte de cession d’une manse, (terre plantée d’aulnes et de saules, pêcherie), à l’hospice Comtesse en 1248 par Bérard Rihout. On ignore si le lieu a pris ce nom (ensuite transformé en Rihour) de son ancien propriétaire propriétaire ou l’inverse. Elle est encore mentionnée en en 1374 dans la cession à l’hospice Comtesse d’un pré près du « neuf fossé » et en 1398 dans les comptes de la ville comme un « riez » (marais). À cette époque et jusqu’à la construction du Palais Rihour au xve siècle, la future place est un terrain humide (prés et arbres) à l’intérieur de l’îlot Rihour bordé au nord-est par le Canal des Poissonceaux (fossé d’une précédente enceinte de la ville du début du xiie siècle ou voie naturelle originelle) qui le sépare de la Grand Place), au sud-est par une partie d’une extension de l’enceinte de la ville créée au xiiie siècle (ensuite canal des Molfonds), au sud-ouest d’un autre tronçon de cette enceinte (parallèle à l’actuelle rue de l’hôpital-militaire), l’ensemble formant un îlot.
À la suite du déplacement de la magistrature de la halle échevinale au palais Rihour, en 1664, Charles de Renaucourt, comparait pour vol de chevaux et d’autres crimes. L’homme est pendu le 12 juillet 1664 à un gibet sur la place.
L’ancienne de la Mairie plus petite que l’actuelle place Rihour est agrandie par la disparition de l’ancienne Mairie de Lille, établie à l’emplacement du Palais Rihour, détruite par un incendie en 1916. Auparavant la place ne communiquait avec la rue du Palais Rihour que par deux étroits passages de part et d’autre de la Mairie, le « contour de l’Hôtel-de-Ville » et la « cour du Frêne ».
La place est immatriculée « LR13 » parmi les îlots regroupés pour l’information statistique (IRIS) de Lille, tels que l’Insee les a établis en 1999.
Le monument aux morts de la place Rihour est l’oeuvre de l’architecte Jacques Alleman (très présent dans la reconstruction de Béthune) et du sculpteur Edgar Boutry ; il a été inauguré en 1927. Sa forme est très inhabituelle. Nous avons affaire à un mur d’environ 8 m de haut, à son sommet un texte adressé aux lillois et plus bas, trois panneaux en bas-relief sur le thème de la guerre.
Aux Lillois
Depuis la place, empruntez la rue de l’Hôpital-Militaire
L’actuelle église Saint-Étienne est en réalité l’ancienne chapelle du collège des jésuites. L’ancienne église de la paroisse Saint-Étienne a été détruite par un incendie en 1792 lors du siège de la ville par les Autrichiens. L’histoire de la chapelle des Jésuites, actuelle église Saint-Étienne, remonte au début du xviie siècle. Après la destruction de l’église Saint-Étienne en 1792, la paroisse se trouve privée de lieu de culte.
C’est ainsi qu’en 1796, l’ancienne chapelle du collège des Jésuites est rouverte au culte et prend le titre d’église paroissiale Saint-Étienne. Le groupe Saint-Vaast organisent, depuis cette église, des maraudes hebdomadaires pour les sans-abris.